
Gros coup de coeur pour ce fabuleux bouquin classé en nature writing. Vraiment. L’expérience et la démarche de Thomas Rain Crow ont une résonance spéciale pour moi car non seulement je partage la plupart de ses convictions mais surtout je me suis un peu reconnue dans sa parenthèse sauvage qui a duré presque 4 années. C’est un texte qui ne peut qu’enrichir son lecteur, et la prose est belle et riche. Merci au traducteur, Mathias de Breyne.
Ecrivain, traducteur et poète, Rain Crowe a fait partie de la Beat generation, a roulé sa bosse un peu partout et a exécuté plusieurs petits boulots le rendant polyvalent, dans le bons sens du terme. Aussi, lorsqu’il décide de franchir le pas – vivre pratiquement en autarcie dans un coin perdu des Appalaches – ses différentes expériences et ses convictions écologistes lui permettent de s’adapter à sa nouvelle vie avec une aisance que je lui ai enviée.
Profitant de l’hospitalité d’un fermier voisin, qui prête le bout de son pré et une petite cabane, Thomas Rain Crowe se prépare à sa vie hors du monde « réel », celui que nous impose le progrès et la civilisation, pour retrouver les plaisirs d’une vie simple et sans entraves, en harmonie avec la nature. Bien sûr, tout n’est pas toujours facile, le corps est sans cesse sollicité, couper du bois mort, travailler son potager bio, réparer ou aménager la cabane (j’ai souffert avec lui lors de la construction du cellier, travail harassant…) ne sont pas des activités de tout repos. Mais au bout de chaque journée, la récompense. Manger ses propres légumes, boire l’eau de la source, marcher en forêt, fraterniser avec les cerfs, écouter et observer les oiseaux qui viennent manger les graines. Apprendre de ses voisins (affûter une lame, confectionner sa première bière maison…), travailler avec les Cherokees sur un répertoire des sites sacrés.
Il aimait aussi s’installer dans son fauteuil près du poêle à bois pour relire Emerson ou Thoreau. Il aimait cette relative solitude et sentir les liens qui l’unissaient à ce bout de terre. Chaque chapitre se clôt par un de ses poèmes, presque tous dédiés à la nature, et ils m’ont bien plu.
S’il a parfois été obligé de prendre le fusil pour défendre ses récoltes, contre marmottes, écureuils ou lapins, il le fait à contrecoeur, parce que c’est une question de survie. Il n’a jamais rien chassé de plus gros, ne tirant ni cerf ni prédateur. L’essentiel de ses repas se compose des légumes et fruits de son jardin, occasionnellement un poisson.

Bref, on est loin du Pete Fromm de Indian Creek (au fil des mois, je déteste de plus en plus ce roman et son auteur !) et c’est tant mieux. Ses points communs avec Sue Hubbell ou Aldo Leopold sont en revanche très nombreux. Ils ont la même vision de l’écologie, de ce qu’elle devrait être. Ce mot qui devient creux à force d’être utilisé à tort et à travers, retrouve ses lettres de noblesse sous la plume de Thomas Rain Crowe.
Il aborde également un problème qui me tient à coeur et que peu de gens qui se qualifient d’écologistes osent aborder : la surpopulation humaine. Je n’ai jamais compris pourquoi la plupart des écolos s’entêtent à démontrer que la terre peut accueillir plus de monde et qu’il sera possible de les nourrir. Ils ne pensent qu’en terme de subsistance (et ça me fait bien rire – jaune – quand on voit que plus de la moitié de la population mondiale ne mange pas à sa faim aujourd’hui !!) alors qu’il faut penser aussi et surtout en terme d’espace et de services. Maison, accès à l’eau potable, bon niveau de vie impliquant des infrastructures et la production toujours grandissante de produits de consommation, même courants, mode de chauffage (et oui, le bois n’est pas inépuisable), etc. Et la contrepartie de tout ça, la réduction des espaces naturels, le bétonnage de la nature, la disparition d’espèces animales, la production de déchets dont nous ne saurons que faire, la nécessité d’avoir un travail ou des revenus, le besoin de loisirs, de biens matériels… On ne peut même pas cohabiter avec des loups ou des éléphants, comment cohabiterons-nous avec d’autres gens, sur des espaces de plus en plus restreints ?
Personne n’évoque non plus cette composante essentielle de l’homme et que l’auteur évoque avec justesse : le besoin élémentaire et vital de certains hommes de vivre dans une certaine intimité, en sûreté et en toute tranquillité. De plus en plus de citadins veulent quitter les villes pour retrouver la paix, loin du bruit, de la foule, de la violence aussi. Mais cette paix s’acquiert à coup de lotissement, de rond-points, de bretelles d’autoroutes, de centres commerciaux érigés là où il y avait des prairies et le bocage, des bois et des animaux. Bref, un redoutable casse-tête que Thomas Rain Crowe a expérimenté à petite échelle.
En effet, l’écrivain a fini par quitter ce coin des Appalaches, rattrapé par le progrès. Il vit aujourd’hui dans une petite ferme près d’une autoroute (ce qu’il déplore), pas complètement ré-adapté à la vie « réelle » mais reconnaissant d’avoir pu vivre cette parenthèse enchantée. Il sait combien les choses dont nous avons le plus besoin sont fragiles et il espère toujours que le bon sens finira par l’emporter. J’en suis moins sûre que lui mais je suis heureuse de savoir que des gens comme lui existent.
C’est donc une magnifique expérience que l’auteur nous rapporte, doublée d’une saine réflexion sur notre place et notre rapport au monde sauvage, dont dépend notre survie. Lecture à compléter, si ce n’est déjà fait, avec L’almanach du comté des sables et Une année à la campagne.

Et comme il évoque le poète Carl Sandburg, je terminerai par ceci :
Early Moon de Carl Sandburg
The baby moon, a canoe, a silver papoose canoe, sails and sails in the Indian west.
A ring of silver foxes, a mist of silver foxes, sit and sit around the Indian moon.
One yellow star for a runner, and rows of blue stars for more runners, keep a line of watchers.
O foxes, baby moon, runners, you are the panel of memory, fire-white writing to-night of the Red Man’s dreams.
Who squats, legs crossed and arms folded, matching its look against the moon-face, the star-faces, of the West?
Who are the Mississippi Valley ghosts, of copper foreheads, riding wiry ponies in the night?—no bridles, love-arms on the pony necks, riding in the night a long old trail?
Why do they always come back when the silver foxes sit around the early moon, a silver papoose, in the Indian west?

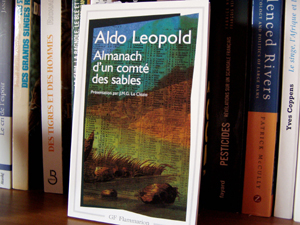




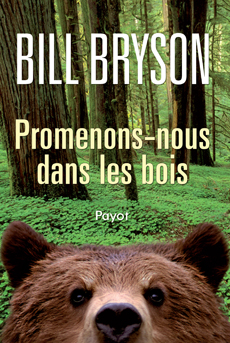
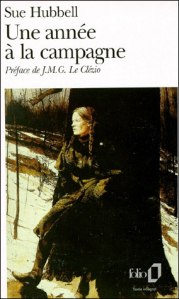

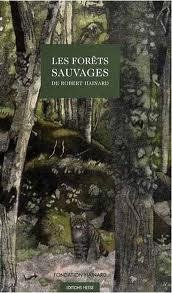


Commentaires récents